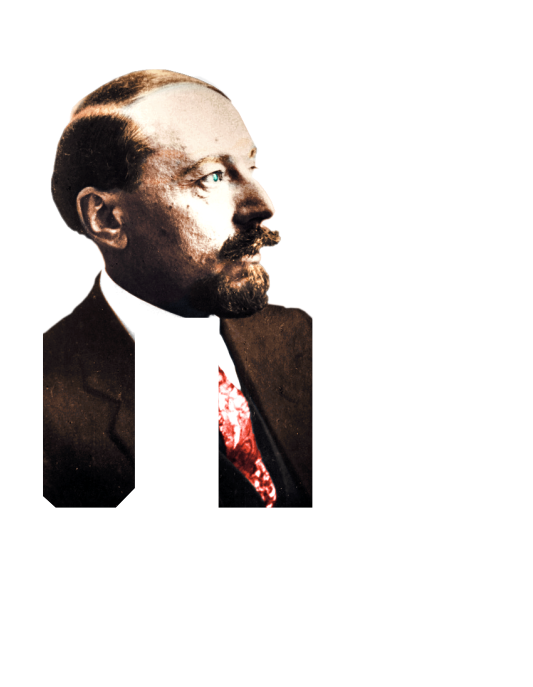Huit heures par jour avec la gomme et les mouchards

Nous vous proposons de relire cet article, paru en 1999 dans le journal Libération, dans lequel un ouvrier Michelin racontait ses conditions de travail. L’importance de Michelin dans la vie ouvrière auvergnate est grande et il nous paraît utile de la mettre en lumière.
Des articles plus anciens ou plus récents suivront celui-ci.
Quatre heures et demie du matin, devant l’usine Michelin de Cataroux à Clermont, des ouvriers sortent d’un bus aux armes de Bibendum. Certains s’engouffrent immédiatement dans l’enceinte de l’usine. D’autres prennent le temps d’aller boire un café à l’Elysée Bar, un des bistrots installés en face de la manufacture. «On passe déjà huit heures là-dedans, on ne va pas se précipiter pour faire du rab, non?» Michel est entré chez Michelin en 1974, à la manutention. «J’avais passé trois ans avant en apprentissage dans le bâtiment. On bougeait tous les jours, raconte-t-il. Quand je suis entré à la Maison, ça m’a fait un choc. Il fallait que je reste devant ma machine, à ne pas bouger, à faire tout le temps les même gestes.» Vingt-cinq ans plus tard, il est toujours là. Et, à cinq heures moins le quart, s’il est d’équipe du matin, il entre dans l’usine. Direction le vestiaire. Il enfile son bleu et sa chemise à carreaux Michelin. Puis se dirige vers le «PX», l’atelier qui fabrique les pièces en caoutchouc utilisées sur les chaînes de fabrication. «Ici, on est un peu plus tranquille [35 personnes, dont 4 femmes, y travaillent] que dans les autres ateliers, confie Michel. On a aussi du rendement à faire, mais c’est un peu moins fatiguant. On travaille toujours sur des petites séries, on change de machine.» Le cauchemar du «23». Avant, Michel travaillait au «23», les pneus neige. «Il fallait faire 200 pneus par jour.» Il y est resté deux ans et se souvient d’en avoir bavé:
Quatre heures et demie du matin, devant l’usine Michelin de Cataroux à Clermont, des ouvriers sortent d’un bus aux armes de Bibendum. Certains s’engouffrent immédiatement dans l’enceinte de l’usine. D’autres prennent le temps d’aller boire un café à l’Elysée Bar, un des bistrots installés en face de la manufacture. «On passe déjà huit heures là-dedans, on ne va pas se précipiter pour faire du rab, non?» Michel est entré chez Michelin en 1974, à la manutention. «J’avais passé trois ans avant en apprentissage dans le bâtiment. On bougeait tous les jours, raconte-t-il. Quand je suis entré à la Maison, ça m’a fait un choc. Il fallait que je reste devant ma machine, à ne pas bouger, à faire tout le temps les même gestes.» Vingt-cinq ans plus tard, il est toujours là. Et, à cinq heures moins le quart, s’il est d’équipe du matin, il entre dans l’usine. Direction le vestiaire. Il enfile son bleu et sa chemise à carreaux Michelin. Puis se dirige vers le «PX», l’atelier qui fabrique les pièces en caoutchouc utilisées sur les chaînes de fabrication. «Ici, on est un peu plus tranquille [35 personnes, dont 4 femmes, y travaillent] que dans les autres ateliers, confie Michel. On a aussi du rendement à faire, mais c’est un peu moins fatiguant. On travaille toujours sur des petites séries, on change de machine.» Le cauchemar du «23». Avant, Michel travaillait au «23», les pneus neige. «Il fallait faire 200 pneus par jour.» Il y est resté deux ans et se souvient d’en avoir bavé: «On découpait une première couche de gomme. On la posait sur de la toile. Puis, on en découpait une seconde, qu’on déposait par-dessus la première dans l’autre sens. Cette espèce de millefeuille de toile et de gomme devait passer ensuite sous une sorte de grosse presse qui lui donne la forme du pneu. Il fallait ensuite le reprendre pour remettre une couche de gomme. Une gomme que l’on devait avoir taillée à la main avant, avec des gros ciseaux. Résultat, on se tournait toujours dans le même sens, on coupait toujours la gomme avec la même main, ça fusille la meilleure des santés. Heureusement, quand les copains ne tenaient pas le coup, on les aidait à faire leur production pendant le casse-croûte. On a toujours essayé de ne laisser personne au bord du chemin.»
De 5 heures à 8 heures, Michel et ses camarades travaillent sans relâche en attendant le casse-croûte. «C’est le meilleur moment. Pendant une demi-heure, on se retrouve dans le réfectoire. Chacun avec notre gamelle, on se place à table selon les affinités. Ça bavarde, mais on fait gaffe à ce qu’on dit; dans cette maison, il y a une vieille tradition de mouchards.» Michel raconte comment, pour une critique prononcée un peu trop fort, certains de ses camarades se sont retrouvés privés d’augmentation ou mal notés. «On a beau avoir vingt-cinq ans de maison, on continue à faire attention. Tout le monde a un pavillon à payer ou une voiture à rembourser, alors il ne faudrait pas être privés d’augmentation à cause d’un moment de colère.» Michel assure pourtant que l’ambiance a changé dans les ateliers. «Aujourd’hui, c’est bonjour, bonsoir. Avant, les gens s’aidaient le week-end pour monter leurs maisons. J’ai quelques bons copains avec moi. Mais, on ne se voit plus tellement en dehors du boulot. On va boire un coup ensemble, et chacun rentre chez soi, avec ses soucis.» Une fois le casse-croûte avalé, les ouvriers retournent dans l’atelier. «On reprend une petite pause à 10 heures, pour boire un café.» Michel explique qu’il fait son travail machinalement, sans réfléchir. «On n’est pas dans un atelier très difficile, on essaye de pas trop se plaindre. J’ai des copains au « Z. Là-bas, ils font les mélanges chimiques pour préparer la gomme, pour que les pneus soient noirs. C’est dégueulasse. Ils sont noirs des pieds à la tête et les bronches en prennent un coup. La gomme, ça pue, ça irrite les poumons, ça fait mal aux yeux. Nous, au fond de l’usine, on travaille parfois dans cette odeur, quand le vent souffle vers nous. On ne la sent plus à force, comme on n’entend plus le bruit.» Sauf lorsqu’ils reviennent de vacances: «Pendant quinze jours, on a eu les poumons nettoyés, on a respiré le bon air. Puis on a replongé dans la saleté et la puanteur.»
«Les jeunes, ils ont envie.» Mais, dit-il, «personne ne se plaint, surtout aujourd’hui. Tout le monde a peur de perdre son boulot, et on est tous assez âgés. Dans mon atelier, on rentre la tête chez les épaules. Quand un jeune débarque, tout change. Parfois, on nous envoie un intérimaire, ou un jeune en stage. D’un coup, on revit. Les jeunes, ils ont envie de travailler, ils font tout pour améliorer les choses. Ils sont dynamiques. Si l’usine embauchait des jeunes, on garderait espoir en Michelin. Là, on ne voit pas de changement, et les stagiaires ne restent jamais. Autrefois, c’était naturel d’entrer à la manufacture à 14 ans pour y faire carrière. Ma soeur et mon frère avaient postulé il y a trente ans de cela. Ils n’ont pas été gardés, Michelin n’en a pas voulu. On avait vécu ça comme une humiliation en son temps dans ma famille. Aujourd’hui, ils ont tous les deux un travail intéressant. Ils ont eu de la chance finalement.»
A 12 h 45, Michel prend le chemin du vestiaire pour se changer: quitter son bleu et ses chaussures de sécurité. «A ce moment-là, je ne pense plus qu’à une chose: filer le plus vite possible, rentrer chez moi. Je ne me préoccupe même pas de l’équipe qui prend le relais. C’est chacun pour soi aujourd’hui».
https://www.liberation.fr/futurs/1999/10/28/huit-heures-par-jour-avec-la-gomme-et-les-mouchards-michel-ouvrier-chez-michelin-depuis-1974-decrit-_287393