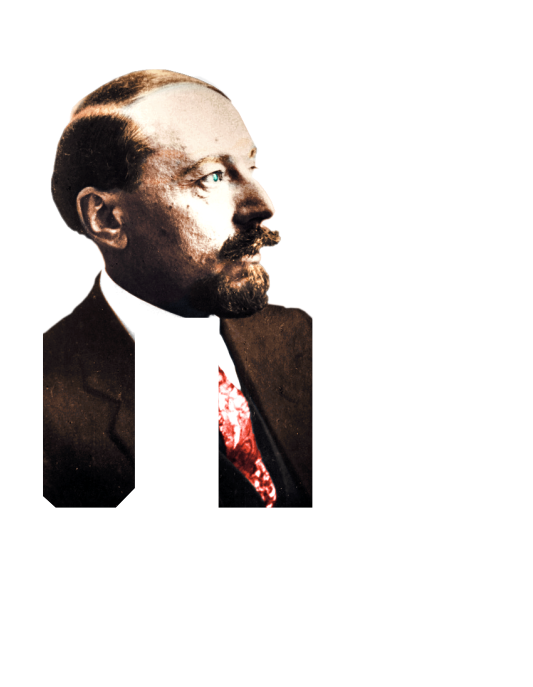Acte XV : Les Gilets Jaunes s’enfoncent toujours dans le néant politique.
Ce 23 février fut l’occasion de voir se dérouler à Clermont-Ferrand le XVeme acte du théâtre grotesque des Gilets jaunes. Fidèles à eux-mêmes, ils ont démontré une fois de plus le vide politique et culturel total qui caractérise leurs révoltes du samedi. Auvergne à Gauche était sur place, en observation. Comme attendu, le mouvement n’a bénéficié d’aucune préparation et organisation. Sa base reste éminemment spontanéiste, et le résultat est au rendez-vous : chacun fait ce qu’il veut, apporte son propre slogan – souvent écrit sur le gilet – dans l’individualisme le plus absolu. Car c’est bien ça, les gilets jaunes : une addition d’individus en colère qui, en étant au même endroit physiquement et géographiquement parlant, s’imaginent que cela suffit à les unir. Voir écrit « Je suis Spartacus. Je reviendrai, je serai des millions. » alors que le mouvement en est déjà à son quinzième acte et peine à mobiliser plus de 46 000 personnes dans la France entière montre bien le ridicule de la situation.

Il n’y a pas de ligne politique commune aux manifestants qui rejettent dans leur grande majorité la politique et n’affirment aucun projet. Si le fameux « RIC » ou l’appel à la démission du président de la République reviennent en boucle, il n’y a aucune autre unité que l’opposition au gouvernement. C’est pour le moins problématique quand on sait que l’opposition peut provenir de la gauche comme de l’extrême-droite la plus virulente. La plupart défilaient pour montrer qu’ils sont « encore là » et qu’ils « ne lâchent rien »… Pour le reste, chacun y est allé de sa revendication phare, celle qui le poussait à venir manifester. Le tout formant un ensemble hétéroclite, brouillon, désorganisé.

On a aussi pu noter la présence de personnages « folkloriques », déguisés en clowns jaunes, en « Marianne », en sans-culottes (au bonnet phrygien jaune…), en gaulois (de type « Astérix », évidemment). Certains utilisaient des sifflets, des cornes de brume, agitaient des tambourins, d’autres des crécelles. D’autres encore tentaient de rythmer le mouvement général à l’aide de percussions. Si lors des manifestations syndicales « classiques », cet aspect folkorique est évidemment présent, il est généralement plutôt coordonné (ceux de la CGT font du bruit au même rythme, ceux de SUD aussi, etc.). Là, chacun faisait de bruit dans son coin, se préoccupant davantage de lui-même que de l’ensemble. Non pas que ces travers là ne soient pas présents à chaque manifestation syndicale, mais leur relative unité quant aux revendications fait qu’il y subsiste généralement une certaine cohérence, une logique générale. Le service d’ordre y est fourni par les syndicats et les organisations participantes, et les éléments les plus radicaux et aux idéologies les plus individualistes (ceux que l’on retrouve justement parmi les gilets jaunes), ne parvenant pas à trouver d’espace à occuper au milieu de cette union politique, suivent derrière, à l’écart de la foule.

Une fois en mouvement, le cortège n’a eu de cesse de se diviser en fonction des groupes d’amis qui le constituaient, montrant une fois de plus que rien, politiquement, ne rassemble ces gens. A la vue des CRS près du palais de justice, certains ont préféré quitter le cortège afin d’aller à leur rencontre, le plus gros de la foule ne suivant le petit détachement que plusieurs minutes plus tard. S’il est vrai que peu après (et régulièrement par la suite), les lacrymogènes de la police forçaient la foule à l’éclatement, cette dernière n’a cependant jamais eu besoin de leur aide pour former des groupes séparés vaquant chacun à leurs occupations… chose qu’il est assez rare de voir dans une manifestation syndicale où les participants sont tous réunis pour une cause, et non par pure volonté d’exprimer stérilement leur mécontentement général.

La violence qui a eu lieu reflétait elle aussi cette absence d’unité et de logique politique. A partir du moment où, aux abords du Palais de Justice, les gilets jaunes ont rencontré les forces de l’ordre (particulièrement nombreuses et, il faut le noter, totalement absentes le long du cortège jusqu’ici), la tension est montée. Aux policiers armés et protégés par leurs boucliers qui attendaient les manifestants, de nombreuses huées injures ont été adressées (notamment un infirmier qui leur annonçait qu’il comptait les « enculer »). Quelques tentatives de contact plus « physique » ont rapidement mené aux premiers usages de gaz lacrymogène par la police. De manière très ciblée, tout d’abord, puis de manière beaucoup plus généralisée, à partir du moment où le cortège est revenu du côté de la place de Jaude. C’est d’ailleurs à Jaude qu’ont ensuite eu lieu les principales dégradations de la journée : poubelles enflammées, pavés arrachés (puis jetés en direction de la police), vitrines brisées, etc.

Peut-être nous fera-t-on le reproche de ne pas distinguer les casseurs des autres manifestants. S’il est certain que plusieurs gilets jaunes – notamment parmi les plus âgés, ou ceux plutôt habitués aux manifestations « classiques » des syndicats et de la gauche – s’en s’ont clairement désolidarisés, ce serait à tort qu’on établirait une séparation entre les casseurs et le mouvement dans son ensemble. En effet, outre le fait qu’une partie de la casse se soit faite sous les acclamations (et pour certains, le voyeurisme malsain), c’est leur logique même qui est identique à celle du mouvement global. Comparons, une fois encore, cette manifestation avec les manifestations syndicales classiques. Comment expliquer qu’il y ait bien davantage de violence et de casse avec les GJ qu’avec les syndicats ? C’est que l’esprit y est tout de même assez différent, bien qu’il existe des points communs. Les manifestations syndicales sont, par définition, motivées par des raisons économiques et, indirectement, politiques. De plus, dirigées par les syndicats, elles sont très cadrées et suivent sempiternellement le même petit train-train où l’on proteste sans réellement sortir du cadre restreint prévu par les syndicats (qui revendiquent mais n’oublient pas qu’ils restent toujours des « partenaires sociaux » de l’Etat et du patronat, qui les subventionnent à millions). Dès lors, la casse ne rime à rien et ne peut se produire qu’à la marge. On comprend que sans encadrement, la violence peut plus facilement se développer. Toutefois, la violence « jaune » ne s’apparente pas à une violence qui aurait une logique politique. Il ne s’agit pas d’affronter les forces de l’ordre ou d’attaquer tel bâtiment pour un motif symbolique mais simplement d’attaquer pour attaquer, casser pour casser. Ce nihilisme traverse tout le mouvement et la violence qui s’exprime n’en est que le prolongement logique.

Evidemment, ce nihilisme ne peut exister seul et s’accompagne de toute une série de considérations qui viennent combler d’un idéalisme romantique le vide abyssal du mouvement. N’étant pas en réelle rupture avec le capitalisme, ils doivent donc se se débrouiller pour remplir le vide avec ce qui n’entre pas en conflit avec ce mode de production. Pour cette raison, les gilets jaunes adoptent une logique identitaire, nationaliste et, au bout du compte, fasciste. Les drapeaux tricolores, parfois géants, étaient nombreux et agités dès le rassemblement sur la place du 1er Mai. Certains étaient décorés de symboles comme un gilet jaune peint en leur centre. D’autres avaient amené les drapeaux de leur région, ou de leur département, comme ce manifestant brandissant son drapeau du Puy-de-Dôme, n’ayant rien d’officiel ni d’historique par ailleurs, ou ce petit groupe de « bonnets rouges », dont l’un était encapé dans le « Gwenn Ha Du » breton. Il régnait une ambiance bien plus proche de ce qui se fait de pire dans l’attitude d’un supporter de foot que d’une manifestation syndicale, et bien évidemment encore moins d’un mouvement authentiquement populaire. C’est ainsi qu’on a pu voir des militants de l’UNEF manifester aux côtés de fascistes ou de gens qui comparaient pathétiquement les CRS à la Wehrmacht (dans ce cas, que dire de la police gaulliste qui, elle, tuait et torturait ?), ou voir des « insoumis » parler de « raz-de-marée » social et écologique (ou encore se lancer dans le complotisme, comme ce « co-animateur » des Jeunes insoumis du Puy-de-Dôme qui dénonce le « gazage » comme une tentative des CRS d’empêcher le peuple d’aller vers la « Banque de France »… sauf qu’il s’agit du tribunal…).

Evidemment, si le mouvement se distingue clairement, comme on l’a dit, d’une manifestation syndicale, il est un fait qu’une partie des participants étaient des habitués des manifestations « cégétistes ». Parmi le capharnaüm des revendications improbables, complotistes ou hors-sujet, ressortaient ça et là des revendications économiques généralement portées par les syndicats ou la gauche habituée des cortèges. Ici, c’était la hausse du SMIC ou des minima sociaux qui était réclamée, là c’était le retour de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou la retraite à 60 ans. Si ces propositions sont parfaitement légitimes et justes, c’est leur présence dans un tel mouvement qui interroge. Comment se retrouvent-elles au milieu de ce globi-boulga qui rejette ouvertement la Gauche ? La réponse est simple. La Gauche française un tant soit peu revendicatrice se contente aujourd’hui, pour une large part, de suivre le syndicalisme dans son économisme et son refus de la politique. C’est une constante en France depuis la charte d’Amiens qui sépare artificiellement les syndicats des partis de Gauche, à rebours de ce qui s’est pratiqué chez les sociaux-démocrates historiques, notamment en Allemagne. On en arrive à une « Gauche » réduite à son strict minimum : le para-syndicalisme. Et force est de constater qu’elle finit par se fondre dans le populisme ambiant. Comment pourrait-il en être autrement ? A force de clamer que les syndicats doivent être séparés des considérations politiques, tout en essayant de les copier, il était évident que cette Gauche ne pourrait tenir. Ainsi, l’économisme syndical peut très bien se fondre dans l’apolitisme revendiqué par les GJ, et mène leur refus total de la Gauche.

Parmi les slogans et revendications qui sont souvent revenus, on a eu le « RIC » et « Macron démission ». Evoquons-les rapidement. Le « RIC » est, par définition, opposé aux valeurs de la Gauche. Certes, il est d’apparence démocratique. En réalité, il n’est que populiste. Le référendum, par principe, se contente de proposer un choix entre l’approbation totale et le refus total, à une question pré-définie. Il est évident que ce manichéisme est anti-démocratique, puisqu’il est sans nuance et, de ce fait, n’appelle aucune réflexion profonde puisqu’il ne s’agit pas d’élaborer une politique de manière construite. De plus, la formulation de la question dépend de celui qui en est à l’origine. Dire que les « citoyens » pourraient en être à l’origine est ridicule car, quoi qu’il arrive, il s’agira forcément d’un groupe de citoyens précis. Ainsi, plutôt que porter le projet d’une organisation des masses en des assemblées élaborant la politique et faisant vivre la démocratie comme construction commune consciente, on préfère le projet du plébiscite populiste. On rappellera que le référendum d’entreprise est régulièrement utilisé pour contourner les syndicats qui sont, malgré leurs nombreux défauts, une forme d’organisation consciente des travailleurs qui élaborent par leur voie une ligne de revendications. De toute façon, une bonne part des GJ sait pertinemment que le RIC ne peut être mis en place totalement dans le cadre des institutions. De la même manière, seuls les plus délirants d’entre eux peuvent croire qu’ils obtiendront la démission d’Emmanuel Macron, qui de surcroît ne changerait strictement rien à leur quotidien. Dans ce cas, pourquoi revendiquer ces deux points avec autant de fougue ? C’est qu’il s’agit là de mythes mobilisateurs, dans l’esprit de Georges Sorel. Ces mythes « transcendent les âmes » des individus. Ils sont le moteur d’un mouvement qui rejette la politique et la construction organisée. Ce n’est pas une manifestation consciente de gens organisés mais le mouvement d’un ensemble d’individus « transcendés » par ces mythes. L’unité se fait sur une base uniquement idéaliste. Comme chez Sorel, d’ailleurs, l’existence vivante de ce mouvement, sa radicalité (et même sa violence) ont pour but de « réveiller » le capitalisme, jugé « endormi », mauvais gestionnaire car imbu de pouvoir. Les GJ n’entendent pas changer la société, l’Etat, les institutions. Ils veulent qu’on les « entende », que l’Etat change leur quotidien, que les capitalistes soient moins « profiteurs ». D’où les nombreux « Macron menteur », « Non à la corruption », etc. Il s’agit simplement de réveiller ceux qui dirigent la société et pas de la changer en profondeur. C’est dans la même veine que le culte du sauveur suprême, du dirigeant fort et charismatique qui aura suffisamment de « poigne » pour « régénérer le pays ». C’est dans la veine du fascisme.

Le « mythe mobilisateur » est une des composantes de tout mouvement fasciste. Et qui parle de fascisme parle inévitablement de complotisme et d’antisémitisme. Le mouvement des gilets jaunes en est infiltré à tous les niveaux. Ainsi, nous avons eu la joie de pouvoir lire des choses comme « Non au nouvel ordre mondial », comme si Macron et son gouvernement allaient dans le secret changer la face du monde en étant manipulés par une force supérieure, d’ailleurs souvent attribuée aux Juifs, aux franc-maçons, ou aux illuminatis. Il y était aussi question, pour certains, de « Frexit », comme volonté de repli de la nation sur elle-même, propre à un rejet d’une Europe fantasmée de la « finance » qui entraverait la bonne marche économique du pays. Il n’est d’ailleurs rien d’étonnant à trouver cette revendication au sein des gilets jaunes, car beaucoup d’entre eux suivent le politicien d’extrême-droite François Asselineau. On est ici pleinement dans le nationalisme, le populisme, et il est assez aisé pour quiconque se trouve à Gauche de voir clair à travers tout ça : le mouvement des gilets jaunes s’inscrit dans une tendance de pré-fascisme au mieux, ou de fascisme au pire.