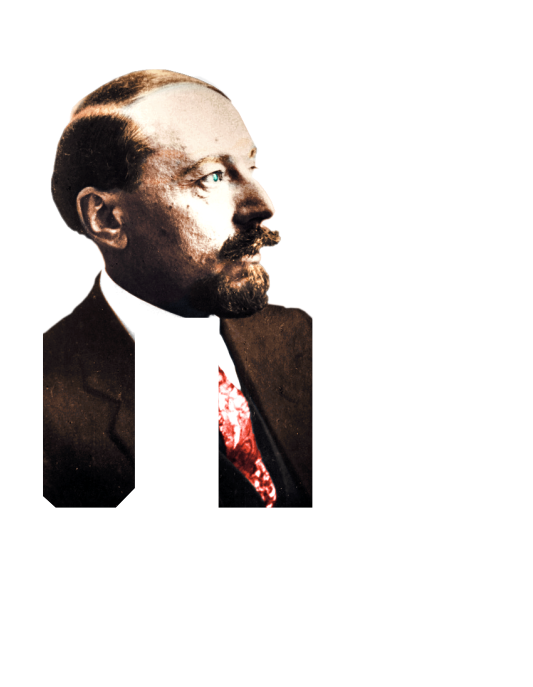Entrevue avec le collectif « Focus LGB »
Récemment, est apparu un petit collectif, nommé Focus LGB qui, comme son nom l’indique, entend défendre la cause des homosexuels et bisexuels de tout sexe. Si une orientation non-partisane est revendiquée, contrairement à nous, nous avons souhaité entamer le dialogue avec ces militants. A l’heure où cette noble cause est prise en étau entre la réaction old school et le post-modernisme agressif, nous nous intéressons évidemment à ce qui semble réaffirmer un peu de bon sens. L’avenir dira si une initiative comme celle-ci peut se développer et contribuer à la réaffirmation d’une ligne correcte et solide sur le long terme.
Auvergne à Gauche appuie tout ce qui va dans ce sens, combat ce qui va dans le sens inverse, et demeure ouverte à ceux qui, parmi les défenseurs de la dignité universelle, s’interrogent, tâtonnent, ou simplement sont prêts à confronter posément leur vision à la nôtre pour faire vivre le débat et la réflexion.
Q1 : Qu’est-ce qui vous a poussé à fonder ce collectif ? Comment vous êtes-vous regroupés, au départ ?
Nous avons créé FocusLGB face au constat que, depuis plusieurs années, les organisations censées représenter les homosexuels et les bisexuels ont progressivement délaissé ces causes pour se concentrer presque exclusivement sur d’autres combats, en particulier liés à l’« identité de genre ». Cette évolution a créé un décalage profond, les préoccupations et les droits spécifiques des LGB n’étant plus portés avec clarté. Plusieurs d’entre nous échangeaient depuis longtemps, en ligne et en dehors, sur ces sujets. Nous avons réalisé que ce sentiment n’était pas isolé : beaucoup d’homosexuels et de bisexuels partageaient la même frustration. Nous avons donc décidé de nous regrouper autour de principes simples et fermes, centrés sur la réalité biologique de l’orientation sexuelle, la laïcité ou encore l’indépendance politique, afin de redonner une voix claire et cohérente aux LGB. Nous ne sommes pas une association de terrain mais un collectif qui cherche à informer, sensibiliser et documenter. Nous produisons des analyses, des mises au point, des rappels historiques et des décryptages pour montrer que les dérives actuelles du militantisme LGBTQIA+ ne sont pas une fatalité et qu’une autre voie est possible.
Q2 : Vous n’êtes pas une association de terrain, mais envisagez-vous, au besoin, de collaborer avec certaines d’entre elles ? Y a-t-il des assos de terrain qui vous paraissent faire du bon travail, concernant les LGB ?
Si nous avons choisi de créer un collectif indépendant plutôt que de rejoindre une association déjà existante, c’est parce qu’aucune ne nous semblait pleinement alignée avec nos préoccupations. Certaines associations font sans doute un travail utile et nous partageons avec elles plusieurs constats de fond. Mais à chaque fois, il reste des points essentiels de divergence : certaines continuent d’inclure des thématiques LGBT+, d’autres adoptent un ton qui ne correspond pas à notre démarche. Notre approche est de rester centrés sur l’orientation sexuelle, avec un discours clair, rigoureux, mais sans excès. Une coopération ponctuelle n’est pas exclue, mais elle resterait marginale : notre raison d’être est justement de porter une voix indépendante et recentrée sur les LGB.
Q3 : Votre apparition sur Twitter/X a fait réagir les milieux transactivistes, qui ont tôt fait de vous assimiler à des réactionnaires et à proférer à votre encontre insultes et menaces. Comment avez vous vécu et géré leurs attaques ? Comment expliquez-vous cette effervescence immédiate de leur part ?
Nous nous y attendions. Et peut-être même à pire. Ce type d’attaques est devenu un réflexe dans certains milieux : toute voix qui ne valide pas leur discours est aussitôt qualifiée de « transphobe » ou d’« extrême-droite », au point que ces mots ont perdu toute force et toute signification. Dès les premiers jours, nous avons reçu des insultes, des menaces et des prédictions sur notre disparition imminente. Mais cela a été largement compensé par un flot de messages de soutien : des homosexuels et bisexuels nous disant enfin se reconnaître dans un discours qui parle de leurs droits et de leur réalité et non de causes qui leur sont étrangères. Nous pensons que cette effervescence vient du fait que, d’ordinaire, les organisations sont très perméables au transactivisme. Cette fois, elles se heurtent à un collectif qui, dès le départ, annonce qu’il ne cédera pas sur ses fondamentaux. Ce n’est pas dans leurs habitudes, et cela les déstabilise.
Q4 : Est-ce-à dire que vous estimez que les transactivistes évoluent aujourd’hui en terrain conquis ?
Sur les réseaux sociaux, les transactivistes donnent effectivement l’impression d’évoluer en terrain conquis. Ils s’expriment dans une bulle où ils interagissent surtout entre eux, ce qui nourrit l’illusion de détenir la vérité absolue. Leur influence repose aussi sur une stratégie de peur : quiconque s’écarte de leurs thèses est aussitôt étiqueté « facho » ou « transphobe », et peu de gens souhaitent porter un tel stigmate. Beaucoup préfèrent donc se taire ou afficher un accord de façade. Même au sein du milieu LGBTQIA+, la pression publique pousse à les soutenir, mais dans les discussions privées on constate souvent que nombre de personnes se sentent bien plus proches de nos positions que des leurs. Leur domination est donc fragile et artificielle. Une illusion de « terrain conquis » plutôt qu’une réalité solide.
Q5 : Dans votre « fil » fondateur, vous faites référence aux luttes historiques des LGB. Y a-t-il des organisations, des événements ou initiatives précis dans lesquelles vous vous reconnaissez ?
Nous nous reconnaissons dans de nombreuses étapes des luttes LGB. Bien sûr, les émeutes de Stonewall en 1969 font partie de notre héritage, mais elles ne sont pas l’alpha et l’oméga de notre combat. Nous nous inspirons aussi de mouvements et d’initiatives moins connus mais essentiels : la création du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) en France dans les années 70, les mobilisations contre la criminalisation de l’homosexualité dans plusieurs pays européens ou encore la lutte contre le sida dans les années 80-90, où la solidarité primait sur les divisions. Au sein de notre collectif, la plupart d’entre nous ont participé à des manifestations depuis les années 2000 : marches des fiertés, combat pour le mariage pour tous… À l’époque, toutes les composantes LGBT défilaient ensemble sous un même drapeau arc-en-ciel, avec des objectifs clairs et communs. On ne segmentait pas les cortèges selon l’origine, le genre, le statut ou la profession. L’esprit était à l’unité, et cela fonctionnait. Nous voulons retrouver cette clarté et cette cohésion. Mais il faut aussi reconnaître qu’une fois la plupart des revendications LGB obtenues, beaucoup se sont désengagés, laissant le terrain libre à des militants radicaux qui ont détourné le mouvement initial. En nous éloignant, nous avons tous une part de responsabilité dans la situation actuelle. C’est pourquoi FocusLGB veut contribuer à réorienter le combat vers son cœur : l’égalité et la dignité des LGB.
Q6 : Au sujet de l’histoire des LGB on peut voir, notamment en Europe, que les trois lettres ont été traitées différemment. Les gays considérés comme « féminins » par la société patriarcale et les lesbiennes niées pendant des siècles. Le combat LGB s’inscrit-il dans une démarche anti-patriarcale féministe ?
Il est évident que l’histoire des LGB a été façonnée par des rapports de pouvoir issus de la société patriarcale : l’homme hétérosexuel placé au sommet, l’homme gay moqué ou dévalorisé, et la femme lesbienne souvent invisibilisée, y compris dans nos propres communautés. Reconnaître ces mécanismes est indispensable pour y répondre efficacement. Notre collectif lutte contre l’homophobie et contre la misogynie, deux discriminations qui cohabitent fréquemment chez les mêmes personnes. Cela inclut la défense des espaces dédiés aux femmes, face aux intrusions d’hommes s’identifiant comme femmes dans des lieux qui leur sont réservés, ainsi qu’à l’effacement de leurs droits et de leur visibilité. Sur ce point, notre démarche peut croiser celle du féminisme, mais nous ne cherchons pas à nous étiqueter ainsi. Nous considérons qu’il s’agit avant tout de respect des réalités matérielles et de bon sens, qui devraient dépasser les clivages politiques.
Q7 : Vous réaffirmez l’importance de l’orientation sexuelle, fait biologique, face au concept d’ « identité de genre » qui relève de la subjectivité. Cela rappelle l’opposition entre matérialisme et idéalisme. Cherchez-vous à réaffirmer cette opposition, si oui comment et pourquoi ?
Oui, on peut le formuler ainsi. Nous affirmons que l’orientation sexuelle est un fait matériel : elle repose sur la réalité biologique du sexe et non sur un ressenti ou une auto-identification. Les concepts d’homme, de femme, d’homosexualité ou de bisexualité ont des définitions précises, construites sur des constats objectifs. Lorsque ces définitions sont remplacées par des perceptions individuelles, on bascule dans l’idéalisme : chacun invente sa propre signification, ce qui conduit à la confusion et, dans notre cas, à l’effacement même des réalités que nous défendons. En droit comme dans la vie quotidienne, on a besoin de repères clairs pour agir et trancher. Dire que « les mots ont un sens » n’est pas un slogan : c’est la base d’un langage commun et d’une protection efficace des droits. Abandonner ce socle matériel, c’est ouvrir la porte à toutes les dérives et à l’arbitraire.
Q8 : Des études ont démontré que ceux qui souffrent de dysphorie de genre sont dans une proportion non négligeable des homosexuels qui rejettent ce qu’ils sont. Est-ce à dire qu’en remettant en avant la cause de l’orientation sexuelle (homo ou bi), vous leur tendez également la main ?
Ça fait partie des sujets qui nous motivent dans notre démarche. Il semble que de plus en plus d’homosexuels soient incités à envisager un changement de sexe plutôt qu’à s’accepter tels qu’ils sont. Comme si une femme « butch », un garçon manqué ou un homme efféminé ne pouvait plus, aujourd’hui, être simplement homosexuel, et qu’il fallait très tôt leur souffler l’idée d’une transition médicale. Souvent, ces personnes ignorent les mutilations irréversibles et les effets secondaires graves que cela implique, et se retrouvent piégées dans des situations où le retour en arrière est impossible. FocusLGB veut rappeler aux plus jeunes : « Si vous êtes un mec efféminé ou une nana masculine, vous êtes l’un des modèles qui existent parmi l’infinie diversité humaine, et c’est très bien comme ça. » Nous ne nions pas que certaines personnes ont un trouble de l’identité qui justifie une prise en charge médicale, mais cela ne devrait jamais être une réponse par défaut à des stéréotypes de genre ou à une mode militante. Dans ce contexte, le rôle des médecins et d’un accompagnement psychologique sérieux est absolument essentiel.
Q9 : Considérez-vous également que les fameuses « transitions » ressemblent à des formes renouvelées de thérapies de conversion ? Que pensez-vous des évolutions récentes des autorités sanitaires au Royaume Uni en la matière ?
Nous considérons que les transitions peuvent devenir de véritables thérapies de conversion lorsqu’elles ne sont pas éclairées, accompagnées de manière sérieuse et pleinement justifiées médicalement et psychologiquement.
Parmi nos soutiens, certains se définissent comme transgenres, et nous nous retrouvons d’ailleurs sur de nombreux combats. Notre démarche n’est pas « transphobe », mais s’attaque aux activistes qui exercent des pressions, notamment sur les plus jeunes, en leur insufflant des idées qui ne sont souvent pas la réponse dont elles ont besoin pour se sentir bien dans leur corps et dans la société. Nous saluons donc les évolutions récentes au Royaume-Uni, notamment l’interdiction des interventions médicales irréversibles sur les mineurs et la création de centres régionaux d’évaluation axés sur un accompagnement psychologique approfondi avant toute décision. En France, si l’interdiction des thérapies de conversion a été un premier pas important, nous pensons qu’il faudrait aller plus loin en s’inspirant de l’approche britannique pour mieux encadrer les interventions médicales sur les jeunes.
Q10 : Vous dites défendre des « droits » et pas des « modes ». Pouvez-vous expliquer l’emploi du terme de « mode » ?
Les combats que nous défendons concerne les Lesbiennes, les Gays et les Bisexuels. Ce sont des droits fondamentaux, liés à une réalité sociale et biologique qui traverse l’histoire humaine et qui dépasse les clivages politiques et sociaux. Ils ne dépendent pas d’une actualité passagère ni d’une cause à la mode. Notre discours est posé, réfléchi, construit sur le long terme, avec le recul nécessaire pour comprendre les enjeux profonds. D’autres causes sont tout aussi légitimes et nous respectons pleinement ceux qui s’engagent pour elles à titre individuel. En revanche, nous avons du mal à percevoir une cohérence politique lorsque certains militants soutiennent tour à tour des mouvements très divers (BLM, Palestine, LGBTQIA+ ou encore des causes religieuses) comme s’ils suivaient simplement la « cause du moment ». Nous pensons qu’un collectif doit avoir une ligne claire et constante. C’est pour cela que nous choisissons de nous concentrer exclusivement sur la défense des droits LGB et pour ça aussi que nous ne sommes pas un courant politique.
Q11 : On serait en droit de voir, derrière cette idée de « mode », une dénonciation de la société de consommation poussant les individus à être consommateurs de leur propre existence, à choisir ce qu’ils désirent être dans un « catalogue des oppressions et des identités ». Etes-vous de cet avis, et si oui, pouvez-vous expliquer votre position ?
Au-delà de la mode passagère des causes à soutenir, nous assistons effectivement à un phénomène où la société de consommation pousse les individus à devenir, comme vous le dites, les consommateurs de leur propre identité. Le « catalogue des identités à la mode » (homosexuel, transgenre, non-binaire, queer, genderfluid, agenre et bien d’autres) fonctionne un peu comme une gamme de produits parmi lesquels chacun peut choisir celui qui lui convient le mieux. Cette dynamique reflète une société où l’individu est invité à se définir par une étiquette, parfois mouvante, souvent sélectionnée en fonction d’une forme d’appartenance ou d’une identification à une oppression spécifique. Ce processus, largement influencé par les tendances sociales et médiatiques, brouille les revendications politiques historiques des personnes qui demandaient simplement le respect, la reconnaissance et l’égalité. Nous pensons que ce phénomène, sous l’emprise de la logique consumériste, affaiblit la cohérence et la visibilité des luttes LGB traditionnelles. En fragmentant ainsi les identités, il devient plus difficile pour la société de comprendre et de défendre des droits clairs et concrets.
Q12 : Vous parlez donc de « revendications politiques historiques » des LGB demandant le respect, la reconnaissance et l’égalité. N’y voyez-vous pas une contradiction avec le fait que vous tentez d’être un collectif ne faisant précisément pas de politique et par conséquent se barrant lui même la possibilité d’avoir une valeur historique ?
Nous sommes encore un jeune collectif, qui pour le moment consacre ses luttes sur X et se bat à coup de threads et de réponses. Notre objectif est avant tout de sensibiliser à ce niveau sur des sujets très grand public. Nous espérons grandir, affiner nos luttes, mais pour le moment, nous restons modestes et prudents. La politique, pour l’instant, nous paraît trop étroite et clivante. Nos revendications sont évidemment politiques, au sens où elles concernent la cité et la vie collective, mais elles ne sont pas partisanes. C’est une nuance essentielle. Revendiquer le respect, la reconnaissance et l’égalité n’implique pas de s’aligner sur tel ou tel parti : ce sont des principes universels. D’ailleurs, l’un de nos piliers fondateurs l’exprime clairement : « Nous ne dépendons d’aucun parti et accueillons des membres de toutes sensibilités. Nos positions sont politiques, oui, mais elles transcendent les clivages. Comme l’écologie ou la liberté d’expression, la cause LGB est transversale ».
Q13 : Le militantisme homosexuel (ou bi), notamment masculin, a dans l’histoire aussi eu ses travers : fascination de milieux bourgeois pour la pédérastie antique au XIXe et début XXe siècle (renouvelé dans les années 70 avec une ouverture à la pédophilie au nom de la libération sexuelle), fétichisme de la clandestinité que la société imposait aux homosexuels (avec une culture porno, l’image des « pissotières », un côté marginal revendiqué et surjoué). Comment lutter contre ces écueils détestables et mettre en avant à la fois l’aspect banalement naturel de l’homosexualité et ce que cette mise à l’écart a aussi produit de riche et universel dans la culture ?
Le militantisme homosexuel, comme tous les mouvements sociaux, a connu des travers liés à son histoire et aux contextes dans lesquels il s’est développé. La clandestinité imposée par la société patriarcale a conduit à des formes de marginalité parfois exacerbées, avec des aspects culturels complexes mêlant à la fois richesse et dérives. Les épisodes tels que la fascination pour la pédérastie ou certaines ouvertures déplorables dans les années 70 sont des faits historiques que nous ne pouvons ni ignorer ni banaliser. Ils doivent être analysés avec rigueur et distance critique, sans pour autant définir l’ensemble de la culture LGB. Notre priorité reste aujourd’hui de promouvoir la banalité et la normalité de l’homosexualité et de la bisexualité, en valorisant les apports culturels positifs issus de ces communautés, tout en rejetant ces dérives.
Q14 : De la même manière que les transactivistes se sont greffés sur les luttes LGB pour ensuite les détourner à leur profit, beaucoup utilisent cette noble cause pour faire passer d’autres combats rétrogrades : une défense de la pornographie, du viol tarifé comme « travail du sexe », de la Gestation pour autrui, ou une mise en avant d’une sexualité débridée où la profondeur de la relation laisse place à la multiplication des partenaires et aux pratiques extrêmes. On a pu voir, lors de l’affaire Palmade notamment, certains groupes militants (ou même le torchon Têtu) faire du « chemsex » un élément identitaire forcément lié aux « LGBT ». Quelle est votre position face à ces dérives ? Comment les aborder, si vous souhaitez les aborder ?
Ce type de questions aborde des sujets complexes et sensibles qui dépassent en partie le cadre strict de FocusLGB. Nous n’avons pas nécessairement des positions uniformes au sein du collectif sur tous ces points. Toutefois, un consensus clair existe autour de la nécessité de reconnaître et de sensibiliser aux risques liés à certaines pratiques sexuelles, comme le chemsex, qui concernent une petite partie de notre communauté.
S’agissant de la GPA, nous dénonçons les attaques homophobes qui prennent prétexte du soutien de certains gays et bi à la GPA pour s’en prendre à tous et, par ailleurs, nous préférons défendre l’adoption ou la coparentalité comme solutions alternatives.
Q15 : Vous dites ne pas vouloir mêler votre combat à d’autres causes, laissant néanmoins la liberté à vos membres de les soutenir à titre individuel. Vous n’êtes donc pas partisans de la « convergence des luttes » ou de la fameuse « intersectionnalité » ? Si non, pourquoi ?
Exactement. Beaucoup d’entre nous s’intéressent à d’autres causes à titre individuel, mais ce qui fait que nombre de LGB ne se sentent plus représentés par les organisations actuelles, c’est qu’elles semblent les contraindre à embrasser un ensemble très large de combats, souvent sans lien direct avec l’orientation sexuelle, par exemple la transidentité, les conflits internationaux ou des causes politiques précises. Notre volonté est au contraire de parler au plus grand nombre en restant concentrés sur les enjeux propres aux lesbiennes, gays et bisexuels. Il n’y a pas d’exclusion, simplement un choix clair de rester focus sur nos sujets. Il n’y a pas tromperie sur la marchandise, c’est annoncé dès le nom même de notre collectif. Nous ne pratiquons ni la convergence des luttes, ni l’intersectionnalité dans notre action collective. Cela n’empêche pas nos membres et les gens qui nous soutiennent de mener plusieurs combats à titre personnel. Par ailleurs, parmi les premiers militants LGB, beaucoup étaient issus de milieux précaires ou de l’immigration et portaient parfois des messages de convergence des luttes. Mais aujourd’hui, ce n’est simplement pas notre sujet.
Q16 : Votre collectif défend une ligne « républicaine » et – surtout – « biologique ». Vous affirmez donc que l’orientation sexuelle est une réalité matérielle. Ce matérialisme influe-t-il votre manière de penser concernant d’autres sujets que le combat pour la cause très précise de la lutte LGB ?
Nous affirmons que l’orientation sexuelle est liée au sexe biologique, ce qui constitue un fondement matériel incontournable de notre combat. Nous reconnaissons l’existence des personnes souffrant de dysphorie de genre, qui doivent être soutenues. La dysphorie de genre, lorsqu’elle est claire, durable et reconnue, justifie un accompagnement médical, psychologique et social adéquat, souvent étalé sur plusieurs années.
Cela dit, FocusLGB reste concentré sur la défense des droits des lesbiennes, gays et bisexuels et ne prétend pas avoir une vision globale ou un positionnement philosophique sur absolument tous les sujets politiques ou sociaux. Nous l’avons dit, notre collectif est jeune et doit encore s’affiner, se développer. Le matérialisme que nous revendiquons ici concerne spécifiquement l’orientation sexuelle et ne se traduit pas nécessairement encore par une position déterminée sur d’autres questions. Notre collectif choisit de ne pas s’engager hors de son champ de compétence.
Q17 : Est-ce ce même matérialisme qui vous oppose aux religions, que vous jugez opposées à la cause homosexuelle ? Est-ce par défense de la laïcité que vous affirmez une ligne « républicaine » ? Si oui, pensez-vous que la laïcité peut suffire à maintenir les religions à distance, ou pensez-vous qu’une lutte plus poussée serait nécessaire ?
Les religions ont, de tout temps, manifesté des positions homophobes. Nous ne leur en voulons pas plus que ça, car il est dans leur nature de défendre des modèles familiaux centrés sur la reproduction, un cadre dans lequel les personnes LGB ne s’inscrivent pas biologiquement sans recourir à des modes de parentalité alternatifs comme la coparentalité. Notre ligne est clairement laïque et républicaine car nous défendons le droit de chacun à exercer sa foi librement, tant que cela ne porte pas atteinte à la liberté et à la dignité des autres, en particulier des personnes LGB. Chacun est libre de croire ce qu’il veut, mais la religion n’a pas à s’imposer dans l’espace public ni à dicter les droits des autres. Là est la rupture que nous revendiquons. En d’autres termes, la foi relève de la sphère privée, les droits et libertés relèvent de la sphère publique. Tant que cette frontière est respectée, il n’y a pas de conflit. Mais dès qu’elle est franchie, nous serons là pour la défendre.
Malheureusement, trop souvent, certaines autorités ou croyants, dépassent cette limite en revendiquant ouvertement des positions homophobes qui compromettent l’égalité et les droits fondamentaux. La laïcité est un cadre indispensable pour maintenir ces dérives à distance, mais elle ne suffit pas toujours à elle seule. Une vigilance citoyenne constante, un encadrement légal strict et une mobilisation sociale sont nécessaires pour faire respecter pleinement les droits LGB face à ces tentatives de discrimination justifiées au nom de la religion.
Q18 : Comment envisagez-vous la suite, pour votre collectif ? Des développements en vue ?
Nous avons de nombreux projets pour l’avenir, certains plus ambitieux que d’autres et il est possible que tous ne se réalisent pas. Pour l’heure, notre priorité est de continuer à porter nos idées, soutenir les personnes LGB et sensibiliser le public aux enjeux que nous jugeons essentiels pour l’avenir de notre communauté. Ces objectifs passent avant les individualités qui composent notre collectif. Pour l’instant, notre collectif s’exprime uniquement sur X (Twitter), qui nous permet de diffuser rapidement nos analyses et d’interagir avec un large public. Nous comptons élargir progressivement notre présence à d’autres plateformes et formats, au fur et à mesure que la communauté de soutien grandira. Mais chaque chose en son temps : nous consolidons actuellement nos forces, et lorsque le moment sera venu, nous avancerons vers les étapes suivantes, que nous avons déjà soigneusement définies.